Votre enfant ne se tient jamais tranquille ? Réjouissez-vous ! Le mouvement est indispensable pour permettre le bon développement corporel et intellectuel d’un petit, quand l’urbanisation et les écrans transforment notre quotidien ! Explications de trois spécialistes (kinésithérapeute, psychomotricienne, ergothérapeute) interrogées par la rédaction du magazine Pomme d’Api, avec des exercices pratiques qui aideront votre diablotin à se sentir bien dans son corps… de la tête aux pieds.
Pour grandir, un enfant a besoin de bouger !
“Dès la naissance, et jusqu’à l’âge de 7 ans environ, explique la psychomotricienne Pascale Pavy, le corps est central dans le développement de l’enfant. Sa pensée se construit lorsqu’il a des actions corporelles.” Pendant que l’enfant bouge, touche, ressent, expérimente, son cerveau accomplit son travail de connexion et de mémoire. Et il est soumis à rude épreuve ! Il doit sans cesse réévaluer ses connaissances : à peine a-t-il intégré qu’il est doté de deux bras que ceux-ci grandissent : il doit se faire à leur nouvelle taille. D’où la maladresse, si fréquente à cet âge-là !
Construire une tour de cubes, grimper à une structure de jeux extérieurs, c’est résoudre un problème : ce cube-ci est-il plus gros que celui-là ? Vaut-il mieux mettre ma jambe là, ou me retourner pour saisir cette corde-ci ? En cherchant ses propres solutions, en procédant par essais/erreurs, l’enfant construit sa pensée. Et contrairement à ce que l’on imagine souvent, il est extrêmement concentré lorsqu’il bouge. Le mouvement lui permet aussi d’acquérir des repères dans l’espace (dessus, dessous, entre, à côté), d’évaluer des distances, de coordonner ses gestes et son regard, autant de compétences qu’il faudra mobiliser pour apprendre à écrire, par exemple. Cela vaut pour tout type de gestes, même ceux qui nous semblent banals.
Des petits gestes essentiels pour développer ses compétences
Marion Ysebaert est ergothérapeute, et décrit son métier ainsi : “Il s’agit d’aider les enfants à être le plus autonome possible dans leur vie quotidienne et scolaire.” Elle déplore que l’on valorise davantage les sollicitations cérébrales que gestuelles, alors que les secondes nourrissent l’intellect : “Boutonner sa chemise, faire ses lacets, découper sa viande… Pour gagner du temps, les parents préfèrent les scratchs et les zips. En oubliant que ces petits gestes sont essentiels, y compris pour développer des compétences plus scolaires.”
À bien y regarder, on se plaint surtout de “l’agitation” de nos enfants, lorsqu’elle n’est pas appropriée à la situation. La kinésithérapeute Isabelle Gambet-Drago constate que les enfants d’aujourd’hui s’agitent beaucoup à des moments où l’on voudrait qu’ils “se tiennent tranquilles” (à table, en classe…), mais bougent moins, dans l’ensemble, que les générations précédentes. Les activités physiques, autrefois, étaient plus incontournables : on allait à pied à l’école, alors qu’aujourd’hui, on saute d’une voiture à la salle de classe puis l’inverse, sans avoir marché. On courait, on grimpait aux arbres, on faisait du vélo, on “se défoulait” dehors…
L’urbanisation des modes de vie, l’apparition des écrans “qui occupent les enfants”, l’accélération de la vie quotidienne… ont un impact sur le mouvement physique. Par exemple, qui d’entre nous ne s’est pas agacé de l’attrait de son enfant pour le mobilier urbain ? Pas le temps d’attendre qu’il ait escaladé le banc, qu’elle ait marché tout le long du muret, qu’il ait lancé tous les cailloux… Pourtant, se hisser en haut du mur représente pour les enfants un apprentissage d’une grande complexité qui met en jeu la précision, l’équilibre, la victoire sur l’appréhension, la confiance en soi, la concentration… Des compétences et qualités toutes fondamentales pour “être bien dans ses baskets” à l’âge où l’enfant grandit un peu tous les jours, dans sa tête comme dans son corps !

Les écrans : une entrave au mouvement
Les trois professionnelles sollicitées pour ce dossier (kinésithérapeute, psychomotricienne et ergothérapeute) ont chacune spontanément parlé de l’usage des écrans (tablettes, jeux vidéo) et de l’inquiétude que ça leur procure. “L’enfant a besoin d’éprouver son environnement avec son propre corps, rappelle Pascale Pavy. Si on réduit son environnement aux deux dimensions d’un écran – et l’appellation “3D” ou “tactile” a quelque chose de mensonger – qui lui procure beaucoup de plaisir, il développe la rapidité au détriment du corps, il est moins actif, il a du mal à se concentrer et à accepter l’attente et l’effort.” Isabelle Gambet-Drago complète : “Aujourd’hui, les adultes portent peut-être moins d’attention au corps de l’enfant. On l’occupe devant un écran, quand autrefois on lui donnait un morceau de pâte à modeler. Les parents d’aujourd’hui ont appris avec le toucher mais ils fabriquent une génération sans toucher.” Bref, entre écrans et mouvements, il faut trouver un juste équilibre.
Jeux et massages à faire ensemble pour être bien dans son corps de la tête aux pieds
Le jeu de la pizza
Pas d’idées pour masser ? Faites semblant de préparer une pizza : votre enfant est allongé sur le ventre (ou à genoux) et vous présente son dos (la pâte à pizza). Vous allez la pétrir, la malaxer… en commentant tous vos gestes : “J’étale bien la pâte (vous appuyez avec vos pouces) et je vais jusqu’aux bords (vous débordez sur les flancs), puis j’ajoute la sauce tomate (vous variez les gestes et les ingrédients), les olives, pic pic pic, etc.” Une fois que la pizza est cuite, il faut la couper (vous tracez des “parts” avec votre index). Puis vous inversez les rôles.
Les câlins enroulants
On prend l’enfant sur les genoux, ses épaules contre notre poitrine, sur un canapé, et on lui enserre les genoux de nos bras, pour qu’il forme comme une boule, que l’on peut balancer d’avant en arrière. Le bassin est bien rétroversé, c’est-à-dire en arrière, et le mouvement calme. Même travail du dos allongé sur un tapis. L’enfant peut alors attraper ses pieds comme un bébé et rouler d’avant en arrière, ou d’un côté et de l’autre, en se massant le bas du dos. Si les parents s’y mettent aussi, c’est le fou rire assuré !

Massages et modelages
On peut déjà apprendre à l’enfant à s’automasser : d’abord les orteils, un par un, puis on monte, etc. jusqu’à la tête. On peut bien sûr aussi masser l’enfant, mais il peut lui aussi vous masser : “Quand l’enfant masse la main de l’autre, note Isabelle Gambet-Drago, il utilise sa propre main, et ça lui est bénéfique aussi.” Les massages améliorent aussi l’habileté de l’enfant. Ses “maladresses” sont souvent dues au fait qu’il grandit plus vite qu’il n’intègre son schéma corporel.
Les super pouvoirs de la main
On peut avoir l’impression que le toucher s’en tient à la surface des choses. Est-ce bien vrai ? Pour le vérifier, faites ce jeu. Choisissez quelques objets divers : un fruit ou un gros légume type courge, un objet en bois, un tissu… Les yeux bandés, faites toucher l’objet à votre enfant. Rien qu’en un contact, il pourra évaluer sa température et sa texture. S’il en suit les contours, cela l’informe sur sa forme et sa taille. S’il le soulève, il pourra dire si c’est lourd ou léger. Et s’il le presse, il vérifiera si c’est dur ou mou. Après ça, il paraît évident qu’une tablette “tactile” ne sollicite qu’une infime partie du toucher. Sans compter que le mouvement de l’index sur un écran est très minime par rapport à l’amplitude des bras humains.

Dedans /dehors
On s’assoit ou on s’allonge. On reste silencieux un petit moment. Puis on raconte ce qui s’est passé, ce que l’on ressent. L’enfant va peut-être évoquer ce qui se passe à l’extérieur de lui (“j’ai entendu un bruit”, “quelque chose me grattait”…), ou à l’intérieur de lui (“mon ventre grossit puis il diminue”, “j’ai froid”, “j’ai pensé à…”)… À nous de l’amener, grâce à nos questions, à prendre conscience d’autres choses. C’est un jeu que l’on peut faire à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. En cette saison, on peut en particulier très facilement sentir que l’air que l’on inspire est froid, mais que lorsqu’on l’expire, il s’est réchauffé. Et si on s’allonge dans la neige, on sent dans son dos le froid du sol et sur son ventre la chaleur du corps. Il suffit d’y être attentif !

Conseil pratique : faites la chasse aux jambes pendantes !
 Avez-vous déjà essayé de déjeuner assis sur un haut tabouret sans pouvoir poser vos pieds sur un barreau ? C’est extrêmement désagréable. Et c’est pourtant ce que l’on impose très souvent à nos enfants, à la maison et à l’école. Jambes pendantes, le bassin bascule vers l’avant, le dos se creuse, mettant le corps et le cerveau sous tension : ils vivent une inconsciente sensation de chute, comme si l’on n’était jamais pleinement en sécurité. Physiologiquement, le corps produit de l’adrénaline (l’hormone du stress). Alors que lorsque le bassin peut être rétroversé, c’est-à-dire en bascule arrière, l’ocytocine (hormone du bien-être) prend le dessus, et le calme vient. En pratique, on peut déjà s’assurer qu’à la maison, les enfants disposent de sièges adaptés à leur taille, qui leur permettent de poser leurs pieds.
Avez-vous déjà essayé de déjeuner assis sur un haut tabouret sans pouvoir poser vos pieds sur un barreau ? C’est extrêmement désagréable. Et c’est pourtant ce que l’on impose très souvent à nos enfants, à la maison et à l’école. Jambes pendantes, le bassin bascule vers l’avant, le dos se creuse, mettant le corps et le cerveau sous tension : ils vivent une inconsciente sensation de chute, comme si l’on n’était jamais pleinement en sécurité. Physiologiquement, le corps produit de l’adrénaline (l’hormone du stress). Alors que lorsque le bassin peut être rétroversé, c’est-à-dire en bascule arrière, l’ocytocine (hormone du bien-être) prend le dessus, et le calme vient. En pratique, on peut déjà s’assurer qu’à la maison, les enfants disposent de sièges adaptés à leur taille, qui leur permettent de poser leurs pieds.
“Bouger, c’est grandir dans sa tête”,
extrait du supplément pour les parents du magazine Pomme d’Api, mars 2017 –
Texte : Anne Bideault – Illustrations : Muzo.

Pour aller plus loin… : du yoga pour les petits !

45 enchaînements rassemblés selon des thématiques bien adaptées à chaque moment de la journée : “Rituels du matin”, “Réveiller ses sens”, “Au moment du coucher”… Une belle compilation de la rubrique “yoga” de Pomme d’Api dans un livre-chevalet accompagné d’un CD.


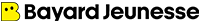

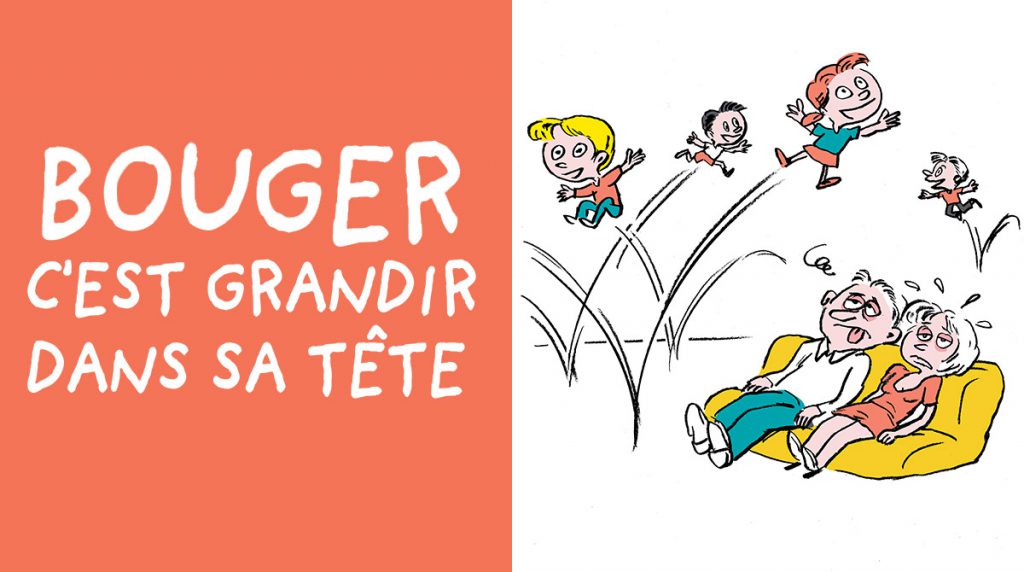




 Avez-vous déjà essayé de déjeuner assis sur un haut tabouret sans pouvoir poser vos pieds sur un barreau ? C’est extrêmement désagréable. Et c’est pourtant ce que l’on impose très souvent à nos enfants, à la maison et à l’école. Jambes pendantes, le bassin bascule vers l’avant, le dos se creuse, mettant le corps et le cerveau sous tension : ils vivent une inconsciente sensation de chute, comme si l’on n’était jamais pleinement en sécurité. Physiologiquement, le corps produit de l’adrénaline (l’hormone du stress). Alors que lorsque le bassin peut être rétroversé, c’est-à-dire en bascule arrière, l’ocytocine (hormone du bien-être) prend le dessus, et le calme vient. En pratique, on peut déjà s’assurer qu’à la maison, les enfants disposent de sièges adaptés à leur taille, qui leur permettent de poser leurs pieds.
Avez-vous déjà essayé de déjeuner assis sur un haut tabouret sans pouvoir poser vos pieds sur un barreau ? C’est extrêmement désagréable. Et c’est pourtant ce que l’on impose très souvent à nos enfants, à la maison et à l’école. Jambes pendantes, le bassin bascule vers l’avant, le dos se creuse, mettant le corps et le cerveau sous tension : ils vivent une inconsciente sensation de chute, comme si l’on n’était jamais pleinement en sécurité. Physiologiquement, le corps produit de l’adrénaline (l’hormone du stress). Alors que lorsque le bassin peut être rétroversé, c’est-à-dire en bascule arrière, l’ocytocine (hormone du bien-être) prend le dessus, et le calme vient. En pratique, on peut déjà s’assurer qu’à la maison, les enfants disposent de sièges adaptés à leur taille, qui leur permettent de poser leurs pieds.






 “Je pense que la poésie, le rêve et l’imaginaire sont un contrepoint magistral face au rationalisme qui veut tout maîtriser. On comble aujourd’hui beaucoup plus les besoins matériels de l’enfant que ses besoins de spiritualité : il a besoin de poser des questions essentielles, d’explorer son imaginaire, de rêver, de jouer. Il est primordial de redonner de l’importance à l’imagination, qui est vitale pour la construction de la pensée. Aujourd’hui, l’enfant reçoit en boucle des images toutes faites. Mais pour nourrir son imaginaire, ce n’est pas de ces images-là dont il a besoin. Il a besoin de paraboles, de récits, de mythes… Il faut aussi laisser jouer librement les enfants. À la maîtresse, au papa et à la maman, aux figurines… L’enfant a besoin de rejouer sa réalité pour pouvoir en devenir acteur : la petite poupée va elle aussi être gardée par la baby-sitter, le Playmobil se disputera avec un copain ou sera repris par la maîtresse. Mais pour que ces jeux éclosent, il faut à l’enfant de l’espace et du temps, ne serait-ce qu’une demi-heure par jour. Il peut alors savourer en toute liberté son espace à lui, hors des contraintes. Même s’il s’ennuie ! L’ennui à petites doses le pousse à la créativité et l’ouvre à sa vie intérieure.”
“Je pense que la poésie, le rêve et l’imaginaire sont un contrepoint magistral face au rationalisme qui veut tout maîtriser. On comble aujourd’hui beaucoup plus les besoins matériels de l’enfant que ses besoins de spiritualité : il a besoin de poser des questions essentielles, d’explorer son imaginaire, de rêver, de jouer. Il est primordial de redonner de l’importance à l’imagination, qui est vitale pour la construction de la pensée. Aujourd’hui, l’enfant reçoit en boucle des images toutes faites. Mais pour nourrir son imaginaire, ce n’est pas de ces images-là dont il a besoin. Il a besoin de paraboles, de récits, de mythes… Il faut aussi laisser jouer librement les enfants. À la maîtresse, au papa et à la maman, aux figurines… L’enfant a besoin de rejouer sa réalité pour pouvoir en devenir acteur : la petite poupée va elle aussi être gardée par la baby-sitter, le Playmobil se disputera avec un copain ou sera repris par la maîtresse. Mais pour que ces jeux éclosent, il faut à l’enfant de l’espace et du temps, ne serait-ce qu’une demi-heure par jour. Il peut alors savourer en toute liberté son espace à lui, hors des contraintes. Même s’il s’ennuie ! L’ennui à petites doses le pousse à la créativité et l’ouvre à sa vie intérieure.”








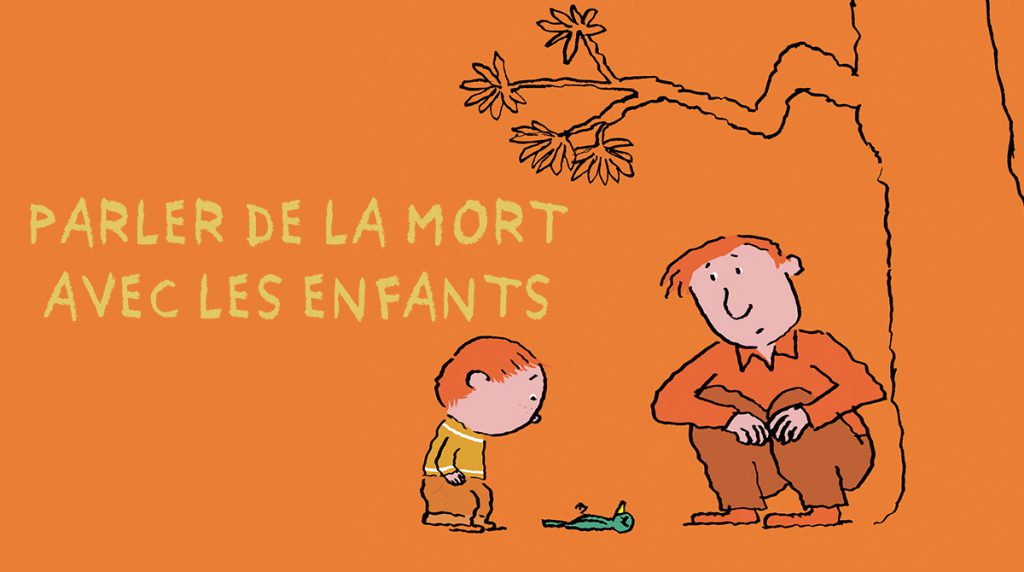
 Sans pour autant devancer leurs interrogations, il ne faut donc pas laisser échapper une occasion d’aborder ce sujet. On peut profiter d’une question, d’une observation (un insecte mort, un oisillon…), de l’irruption de l’actualité dans le quotidien (la radio entendue, le journal télévisé entrevu…), de la mort de personnages fictifs dans un jeu ou une BD. « La mort est omniprésente dans notre société, constate Claire Pinet, mais on n’en parle jamais. Cette condition humaine n’est pas formulée alors qu’elle devrait l’être. » Pour les êtres de parole que nous sommes, parler soulage. C’est le constat qu’a pu faire Myriam, professeure des écoles en CP, dont les élèves ont récemment préféré poursuivre leur discussion sur la mort au lieu d’aller en récréation : « Ils n’avaient pas vraiment de questions mais plus le besoin de raconter la mort, les morts… Un petit a conclu que c’était triste de parler de tout ça mais que ça faisait du bien de le faire parce qu’ils n’osaient pas toujours parler de la mort à leurs parents. » Les questions que posent les enfants évoluent avec l’âge et leur représentation de la mort s’acquiert au fil du temps. Nous avons choisi de nous arrêter sur cinq questions qui illustrent leurs représentations de la mort, à l’âge Pomme d’Api.
Sans pour autant devancer leurs interrogations, il ne faut donc pas laisser échapper une occasion d’aborder ce sujet. On peut profiter d’une question, d’une observation (un insecte mort, un oisillon…), de l’irruption de l’actualité dans le quotidien (la radio entendue, le journal télévisé entrevu…), de la mort de personnages fictifs dans un jeu ou une BD. « La mort est omniprésente dans notre société, constate Claire Pinet, mais on n’en parle jamais. Cette condition humaine n’est pas formulée alors qu’elle devrait l’être. » Pour les êtres de parole que nous sommes, parler soulage. C’est le constat qu’a pu faire Myriam, professeure des écoles en CP, dont les élèves ont récemment préféré poursuivre leur discussion sur la mort au lieu d’aller en récréation : « Ils n’avaient pas vraiment de questions mais plus le besoin de raconter la mort, les morts… Un petit a conclu que c’était triste de parler de tout ça mais que ça faisait du bien de le faire parce qu’ils n’osaient pas toujours parler de la mort à leurs parents. » Les questions que posent les enfants évoluent avec l’âge et leur représentation de la mort s’acquiert au fil du temps. Nous avons choisi de nous arrêter sur cinq questions qui illustrent leurs représentations de la mort, à l’âge Pomme d’Api.




