Il y a des repas en famille où nos nerfs sont mis à rude épreuve. Et quel parent n’a alors jamais rêvé de jeter son tablier ? Quand il s’agit de nourrir nos enfants, nous y mettons beaucoup d’affect. Le savoir peut aider à ajuster nos comportements pour des repas plus sereins.
Autour de la table, l’impact de nos souvenirs d’enfance…
 Rien ne cristallise plus notre angoisse de parents que la relation qu’entretiennent nos enfants avec la nourriture. Réaction naturelle, animale, puisqu’elle touche à la survie. Mais pas seulement, car dans nos casseroles se mélangent des ingrédients psychologiques complexes.
Rien ne cristallise plus notre angoisse de parents que la relation qu’entretiennent nos enfants avec la nourriture. Réaction naturelle, animale, puisqu’elle touche à la survie. Mais pas seulement, car dans nos casseroles se mélangent des ingrédients psychologiques complexes.
Isabelle Filliozat, psychothérapeute, nous invite à nous interroger sur ce qu’évoque la cuisine pour nous, sur l’image que nous en conservons depuis l’enfance, sur les interdits et les permissions que nous y avons reçus. Qui faisait la cuisine ? Avec plaisir ou ennui et lassitude ? À table, qu’attendaient de nous nos parents ? Tout cela joue – dans un sens ou dans l’autre – sur notre attitude actuelle. Quand on a été privé de dessert petit, il peut être difficile de réprimer un “Si tu ne finis pas tes légumes, tu n’auras pas de yaourt !” ou, à l’inverse, on peut avoir envie de laisser son enfant ne manger que du sucré.
Pas facile alors de se déprogrammer pour changer d’attitude. Surtout quand il faut imaginer en vitesse un repas après une journée de travail sous pression, tout en gérant le bain, les devoirs, et la fatigue de la maisonnée…
Au menu, amour ou nourriture ?
 “Je vais lui faire son petit plat préféré, il m’en dira des nouvelles…”, “J’ai préparé ce gratin avec amour et personne ne finit son assiette ?”… Ces phrases, qui ne les a pas prononcées ? Elles traduisent une attente bien précise.
“Je vais lui faire son petit plat préféré, il m’en dira des nouvelles…”, “J’ai préparé ce gratin avec amour et personne ne finit son assiette ?”… Ces phrases, qui ne les a pas prononcées ? Elles traduisent une attente bien précise.
“Inconsciemment, les parents confondent don de nourriture et don d’amour”, notait Maryse Vaillant dans son livre Cuisine et dépendances affectives. Trop souvent, nous préparons à manger pour qu’on nous aime ou pour montrer notre amour. Nous en attendons même de la gratitude. Nous invitons même notre enfant à manger “une cuillère pour Maman, une cuillère pour Papa.” Mais un enfant ne mange pas pour son papa ou pour sa maman, mais pour lui. Rien de neutre dans cette cuillère tendue.
Du refus net… à la décision de manger
Face à nous, un petit d’homme qui sent toutes nos attentes et… décide que, non, il ne mangera pas. Pas avec les couverts, mais à la main ; pas assis, mais debout ; pas l’entrée, mais le dessert… À l’âge Pomme d’Api, un enfant a beaucoup à prouver. En premier lieu, qu’il est un individu singulier, capable de décider. Et donc de refuser, même ses aliments préférés.
Dans le même temps, sa curiosité est immense. Mais toutes ces nouveautés sont difficiles à apprivoiser. Ce qui explique aussi ses refus. Lutter, interdire, forcer – on comprend alors que tout cela est voué à l’échec.
Les parents, selon Maryse Vaillant, ne devraient pas “convaincre” un enfant de manger, mais “lui en donner la possibilité”. En lui permettant de choisir, si nous nous en sentons capables. En acceptant par exemple une période “bananes” (c’est du “vécu”!), qui peut durer plusieurs jours. Tout autre aliment étant systématiquement écarté avec un non très ferme. Quel régime…
Les bonnes manières, oui mais…
 De même, face à l’assiette, n’en demandons pas trop d’un coup à nos enfants. À l’image de ce repas de famille où d’appétissantes tranches de melon avaient été disposées dans chaque assiette. À la vue de ces assiettes, les enfants accourent. Mais une voix sèche assène soudain : “On attend que tout le monde soit assis pour commencer !” Étrangement, l’appétit de certains s’est alors évanoui, soulevant des commentaires pincés : “Qu’est-ce qu’ils sont difficiles !”
De même, face à l’assiette, n’en demandons pas trop d’un coup à nos enfants. À l’image de ce repas de famille où d’appétissantes tranches de melon avaient été disposées dans chaque assiette. À la vue de ces assiettes, les enfants accourent. Mais une voix sèche assène soudain : “On attend que tout le monde soit assis pour commencer !” Étrangement, l’appétit de certains s’est alors évanoui, soulevant des commentaires pincés : “Qu’est-ce qu’ils sont difficiles !”
Eh oui… c’est difficile pour un petit de se plier à nos bonnes manières. L’ensemble des règles de bienséance s’apprend petit à petit. Aussi, si le repas est vécu comme un moment de bonheur autour de la table, nous pouvons fermer les yeux sur une petite bouche pleine et très bavarde…
Apaiser les repas : mode d’emploi
On mange quoi, ce soir ? Quel casse-tête parfois pour échapper à une crise ou à des négociations serrées autour de la table ! Sans cuisiner non plus un menu à la carte pour chacun, voici quelques suggestions pour varier les goûts et les plaisirs et inciter les enfants à sortir du purée-jambon-croque-monsieur-pâtes. Elles demandent un peu de temps mais peuvent faire baisser la tension. À tester durant le week-end ou les vacances, donc.
Faire la cuisine avec eux
Pour développer leurs sens et leur envie de goûter, les associer à la préparation du repas est efficace. Ils en seront tellement fiers ! Équeuter les haricots verts, écosser les petits pois, couper les pommes en morceaux (oui, même à 3-4 ans on peut manipuler un couteau), pétrir la pâte, voir couler la sauce…
Pas la peine de les cantonner à la pâtisserie, tout leur plaît, le sucré comme le salé. Même faire la vaisselle les passionne ! Cela leur prouve que la nourriture n’existe pas sous forme toute préparée. Les parents, eux, doivent s’armer de patience et apprendre à repêcher le jaune tombé dans le blanc !
Tester la fantaisie et la surprise
 Et si on proposait aux enfants un pique-nique sur le tapis du salon ? Et si on faisait un repas orange ? Ou un repas à l’envers, en commençant par le dessert ? Et si les enfants choisissaient le menu aujourd’hui ? Et si l’on faisait un repas qu’on mange avec les doigts ? Enfin, de temps en temps, pour se ménager une vraie pause entre adultes autour d’un repas, pourquoi ne pas faire manger les enfants avant ?
Et si on proposait aux enfants un pique-nique sur le tapis du salon ? Et si on faisait un repas orange ? Ou un repas à l’envers, en commençant par le dessert ? Et si les enfants choisissaient le menu aujourd’hui ? Et si l’on faisait un repas qu’on mange avec les doigts ? Enfin, de temps en temps, pour se ménager une vraie pause entre adultes autour d’un repas, pourquoi ne pas faire manger les enfants avant ?
Les initier aux goûts
Sucré, salé, acide, amer, piquant… Pas facile de mettre des mots sur ce que l’on sent avec sa langue. Incitez vos enfants à décrire les goûts, faites-les parler (“Tu n’aimes pas, mais pourquoi ? Qu’est-ce que ça te rappelle ? Et l’odeur ?…”) Ils adorent les dégustations à l’aveugle : une chips, un bout de courgette crue, un morceau de fromage… Devinez ! Et vous aussi prêtez-vous au jeu…
Respecter une même règle pour tous
Énoncer clairement la règle du jeu des repas en famille : chacun goûte à tout, au moins deux franches bouchées, avant de déclarer s’il aime ou non. Et la prochaine fois que l’aliment se retrouve sur la table, il goûtera de nouveau… Attention, ça vaut aussi pour les parents qui n’ont “jamais” aimé le céleri ! On sera parfois surpris. Bon appétit !
Deux psys qui ont mis leur nez dans la cuisine

Bien dans sa cuisine, d’Isabelle Filliozat, J.-C. Lattès, 2012
L’auteure, qui pratique la méditation, fait de la préparation d’un repas une aventure intérieure. Pour ne plus la vivre comme une corvée !

Cuisine et dépendances affectives, de Maryse Vaillant et Judith Leroy, Flammarion, 2006
Chaque famille vit au rythme des repas. Les auteurs nous proposent d’en comprendre les enjeux. Tout lecteur s’y reconnaîtra par moments.
Anne Bideault – Illustrations Peter Elliot – Supplément parents Pomme d’Api – Février 2014


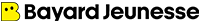


 Rien ne cristallise plus notre angoisse de parents que la relation qu’entretiennent nos enfants avec la nourriture. Réaction naturelle, animale, puisqu’elle touche à la survie. Mais pas seulement, car dans nos casseroles se mélangent des ingrédients psychologiques complexes.
Rien ne cristallise plus notre angoisse de parents que la relation qu’entretiennent nos enfants avec la nourriture. Réaction naturelle, animale, puisqu’elle touche à la survie. Mais pas seulement, car dans nos casseroles se mélangent des ingrédients psychologiques complexes. “Je vais lui faire son petit plat préféré, il m’en dira des nouvelles…”, “J’ai préparé ce gratin avec amour et personne ne finit son assiette ?”… Ces phrases, qui ne les a pas prononcées ? Elles traduisent une attente bien précise.
“Je vais lui faire son petit plat préféré, il m’en dira des nouvelles…”, “J’ai préparé ce gratin avec amour et personne ne finit son assiette ?”… Ces phrases, qui ne les a pas prononcées ? Elles traduisent une attente bien précise. De même, face à l’assiette, n’en demandons pas trop d’un coup à nos enfants. À l’image de ce repas de famille où d’appétissantes tranches de melon avaient été disposées dans chaque assiette. À la vue de ces assiettes, les enfants accourent. Mais une voix sèche assène soudain : “On attend que tout le monde soit assis pour commencer !” Étrangement, l’appétit de certains s’est alors évanoui, soulevant des commentaires pincés : “Qu’est-ce qu’ils sont difficiles !”
De même, face à l’assiette, n’en demandons pas trop d’un coup à nos enfants. À l’image de ce repas de famille où d’appétissantes tranches de melon avaient été disposées dans chaque assiette. À la vue de ces assiettes, les enfants accourent. Mais une voix sèche assène soudain : “On attend que tout le monde soit assis pour commencer !” Étrangement, l’appétit de certains s’est alors évanoui, soulevant des commentaires pincés : “Qu’est-ce qu’ils sont difficiles !” Et si on proposait aux enfants un pique-nique sur le tapis du salon ? Et si on faisait un repas orange ? Ou un repas à l’envers, en commençant par le dessert ? Et si les enfants choisissaient le menu aujourd’hui ? Et si l’on faisait un repas qu’on mange avec les doigts ? Enfin, de temps en temps, pour se ménager une vraie pause entre adultes autour d’un repas, pourquoi ne pas faire manger les enfants avant ?
Et si on proposait aux enfants un pique-nique sur le tapis du salon ? Et si on faisait un repas orange ? Ou un repas à l’envers, en commençant par le dessert ? Et si les enfants choisissaient le menu aujourd’hui ? Et si l’on faisait un repas qu’on mange avec les doigts ? Enfin, de temps en temps, pour se ménager une vraie pause entre adultes autour d’un repas, pourquoi ne pas faire manger les enfants avant ?


 Un objet convoité
Un objet convoité L’été dernier, Agnès s’est fait voler son téléphone portable. Le coupable ? Son neveu de 6 ans, qui l’avait pris dans son sac à main pour le ranger soigneusement dans sa boîte à trésors. Commentaire de la victime : “J’ai réalisé à quel point cet objet peut faire envie aux enfants. Ne serait-ce que parce que les adultes y tiennent beaucoup et y consacrent beaucoup de temps.”
L’été dernier, Agnès s’est fait voler son téléphone portable. Le coupable ? Son neveu de 6 ans, qui l’avait pris dans son sac à main pour le ranger soigneusement dans sa boîte à trésors. Commentaire de la victime : “J’ai réalisé à quel point cet objet peut faire envie aux enfants. Ne serait-ce que parce que les adultes y tiennent beaucoup et y consacrent beaucoup de temps.” À l’opposé, Marie a bien un téléphone, mais elle sait rarement où il est et s’il est chargé. Il laisse ses fils indifférents. Bref, par le rapport qu’ils entretiennent avec leur téléphone, les parents influencent le comportement de leurs enfants. Ceux qui l’ont toujours en main risquent fort de devoir le partager !
À l’opposé, Marie a bien un téléphone, mais elle sait rarement où il est et s’il est chargé. Il laisse ses fils indifférents. Bref, par le rapport qu’ils entretiennent avec leur téléphone, les parents influencent le comportement de leurs enfants. Ceux qui l’ont toujours en main risquent fort de devoir le partager ! À bien y réfléchir, aucun jouet ne coûte aussi cher que celui-là. On comprend la réaction offusquée d’une grand-mère : “Vous lui mettez dans les mains un objet qui vaut 500 euros ?” Pour cette raison, Benoît ne prête son téléphone qu’à certaines conditions : “Il faut que les enfants restent bien assis, sinon, c’est terminé !”
À bien y réfléchir, aucun jouet ne coûte aussi cher que celui-là. On comprend la réaction offusquée d’une grand-mère : “Vous lui mettez dans les mains un objet qui vaut 500 euros ?” Pour cette raison, Benoît ne prête son téléphone qu’à certaines conditions : “Il faut que les enfants restent bien assis, sinon, c’est terminé !” Pour les parents, avouons-le, quelle invention géniale ! “À la maison, c’est rare que je leur permette d’y jouer, explique Benoît, mais dès qu’il faut attendre, on y a recours : dessins animés, coloriages, jeux, musique…” En train, en voiture, en avion, c’est pratique.
Pour les parents, avouons-le, quelle invention géniale ! “À la maison, c’est rare que je leur permette d’y jouer, explique Benoît, mais dès qu’il faut attendre, on y a recours : dessins animés, coloriages, jeux, musique…” En train, en voiture, en avion, c’est pratique. La fonction première du téléphone passe au second plan pour les enfants. Ils l’oublient, même. “Toi ? Un téléphone ? Mais pour appeler qui ?” s’est exclamée Agnès lorsque sa fille lui en a fait la demande en… CE1. La petite a ouvert de grands yeux étonnés : “Mais personne !” Elle ne pensait qu’à toutes les autres fonctions que propose l’appareil, comme d’autres réclament une DS ou une Wii.
La fonction première du téléphone passe au second plan pour les enfants. Ils l’oublient, même. “Toi ? Un téléphone ? Mais pour appeler qui ?” s’est exclamée Agnès lorsque sa fille lui en a fait la demande en… CE1. La petite a ouvert de grands yeux étonnés : “Mais personne !” Elle ne pensait qu’à toutes les autres fonctions que propose l’appareil, comme d’autres réclament une DS ou une Wii.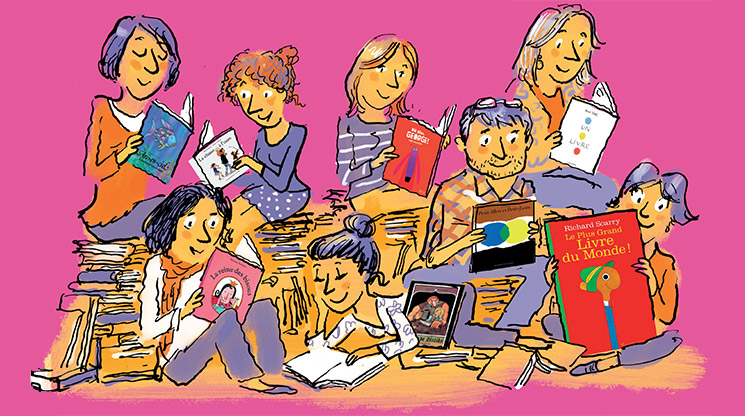


 Poule rousse, de Lida et Étienne Morel, Père Castor Flammarion (1956).
Poule rousse, de Lida et Étienne Morel, Père Castor Flammarion (1956).
 Chien bleu, de Nadja, l’École des loisirs (1989).
Chien bleu, de Nadja, l’École des loisirs (1989).
 Bonsoir lune, de Margaret Wise Brown, Clement Hurd, l’École des loisirs (1981).
Bonsoir lune, de Margaret Wise Brown, Clement Hurd, l’École des loisirs (1981).
 On est les champions ! de Bernard Ciccolini, l’École des loisirs (2005).
On est les champions ! de Bernard Ciccolini, l’École des loisirs (2005).
 pas un loup qui s’attaque aux petits, mais une ogresse. C’est de cette figure de mauvaise mère que la gentille et aimante mère chèvre va triompher. Un conte qui remue et qui fait un peu peur, puis qui rassure, brillamment ciselé par la plume de la conteuse Praline Gay-Para. → Dès 4 ans.
pas un loup qui s’attaque aux petits, mais une ogresse. C’est de cette figure de mauvaise mère que la gentille et aimante mère chèvre va triompher. Un conte qui remue et qui fait un peu peur, puis qui rassure, brillamment ciselé par la plume de la conteuse Praline Gay-Para. → Dès 4 ans.
 Bébés Chouettes, de Martin Waddell, Patrick Benson, l’école des loisirs (1993).
Bébés Chouettes, de Martin Waddell, Patrick Benson, l’école des loisirs (1993).
 Mireille l’Abeille, d’Antoon Krings, Gallimard jeunesse, collection Giboulées (1999).
Mireille l’Abeille, d’Antoon Krings, Gallimard jeunesse, collection Giboulées (1999).
 Ernest et Célestine ont perdu Siméon, de Gabrielle Vincent, Casterman (1994).
Ernest et Célestine ont perdu Siméon, de Gabrielle Vincent, Casterman (1994).
 Un problème pour les adultes
Un problème pour les adultes Ne nous méprenons pas, je préférerais bien sûr que ma fille dise spontanément bonjour et merci ! À plusieurs reprises, nous lui avons expliqué pourquoi cela avait de l’importance pour nous. Mais ces leçons ont surtout eu l’effet désastreux de souligner notre attente et notre crispation. Un cercle vicieux !
Ne nous méprenons pas, je préférerais bien sûr que ma fille dise spontanément bonjour et merci ! À plusieurs reprises, nous lui avons expliqué pourquoi cela avait de l’importance pour nous. Mais ces leçons ont surtout eu l’effet désastreux de souligner notre attente et notre crispation. Un cercle vicieux !

 Les mots qui calment
Les mots qui calment